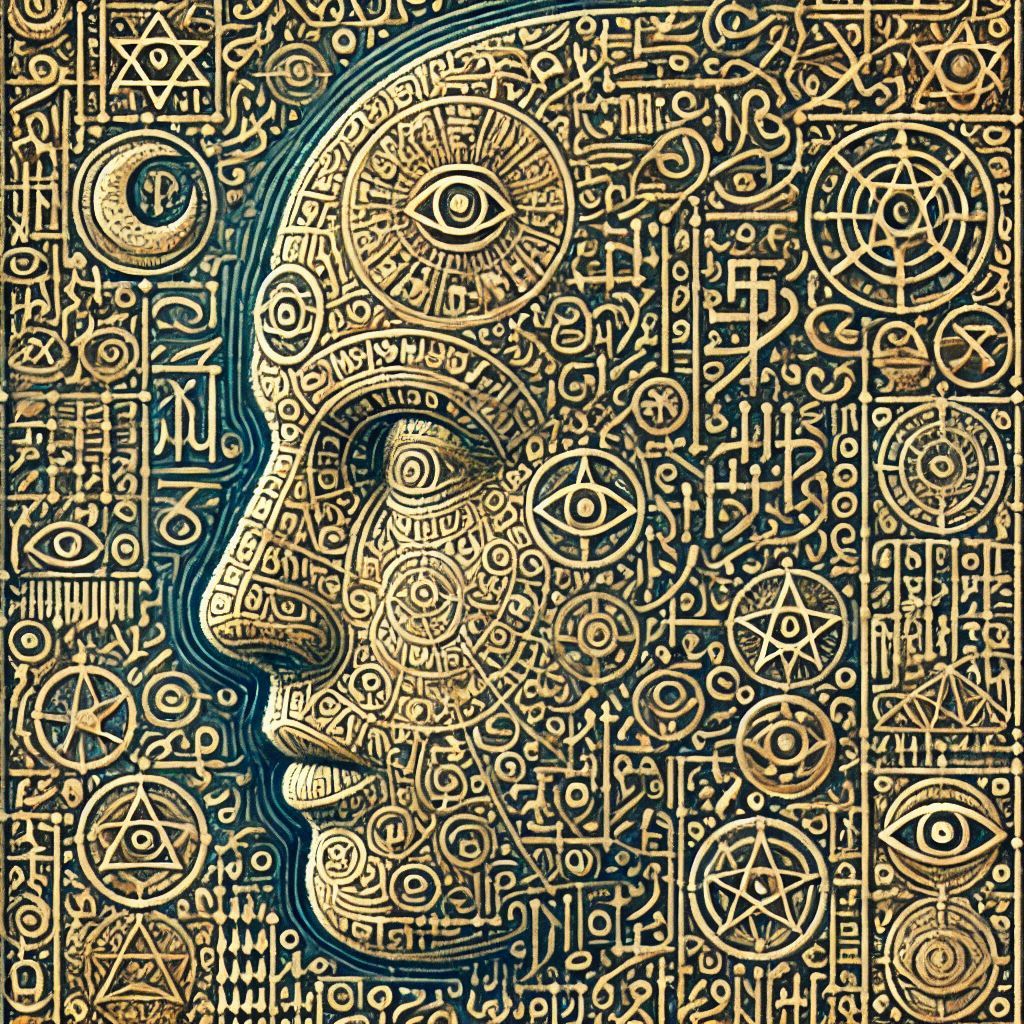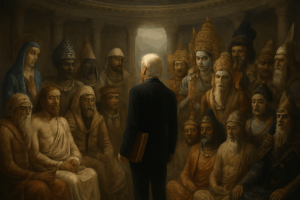Depuis les brumes des cabinets viennois du XVIIIe siècle jusqu’aux laboratoires médicaux du XXIe siècle, le magnétisme n’a cessé de captiver, troubler, émouvoir et diviser. Ce n’est ni une science exacte, ni une superstition pure : c’est un terrain mouvant entre les disciplines, les convictions, les intuitions et les manifestations. Franz Anton Mesmer, père fondateur du « magnétisme animal », le définissait comme une force invisible, fluide universel traversant les corps et les âmes. Mais derrière ce concept se dessine une véritable épopée intellectuelle et spirituelle, dans laquelle des figures aussi diverses que Victor Hugo, Camille Flammarion et bien d’autres, ont cherché à nommer et comprendre l’invisible.
Origines et pensée mesmerienne
Franz Anton Mesmer (1734–1815), médecin viennois, pose les bases du magnétisme animal dans un contexte de rationalisme naissant et d’effervescence pré-romantique. Mesmer affirme l’existence d’un fluide universel reliant tous les êtres vivants, que l’on peut canaliser pour influencer l’état physique et psychique d’un individu. Sa pratique consiste à manipuler ce fluide par des gestes, des regards, des passes, suscitant des crises, des extases, des états de transe. Sa théorie, bien que rejetée par l’Académie royale des sciences française, suscite un engouement populaire extraordinaire.
Le baquet de Mesmer devient symbole : un dispositif où les malades se réunissent, reliés par des tiges de fer à une cuve censée contenir le fluide. Les crises hystériques qui en résultent fascinent les contemporains, tout autant qu’elles inquiètent les autorités. En 1784, deux commissions sont mandatées – l’une par Louis XVI, dirigée par Benjamin Franklin, conclut à l’inefficacité du fluide. Mais cela ne suffit pas à éteindre l’intérêt.
Malgré cette condamnation officielle, le mesmérisme a influencé durablement la pensée médicale et psychologique. Il a ouvert la voie à l’hypnose, au somnambulisme provoqué, et à l’exploration des états modifiés de conscience. Des figures comme le marquis de Puységur ou plus tard James Braid ont repris certains principes pour les intégrer dans des approches plus scientifiques.
Aujourd’hui, le mesmérisme est considéré comme une pseudo-science, mais il reste un jalon important dans l’histoire des idées sur la guérison, la suggestion mentale et les interactions corps-esprit.
Sur le plan culturel, le mesmérisme fascine les écrivains, les philosophes et les artistes. Il apparaît dans les œuvres de Balzac, Poe ou Dumas, et influence les débats sur la conscience, la volonté et les pouvoirs de l’esprit. Il est aussi lié à l’essor du spiritualisme et des sciences occultes au XIXe siècle. En somme, le mesmérisme est à la croisée des chemins entre science, mysticisme et spectacle. Il a ouvert des pistes sur les liens entre corps et esprit, bien avant que la psychologie ne devienne une discipline établie.
Influence sur l’hypnose moderne
Après la condamnation officielle du mesmérisme, certains disciples ont poursuivi ses recherches en les affinant. Le marquis de Puységur, par exemple, découvre que certains patients tombent dans un état de somnambulisme magnétique, une forme de transe calme et lucide, différente des convulsions spectaculaires des séances de Mesmer. Ces états permettent aux patients de répondre à des questions, de se souvenir d’événements oubliés, voire de proposer leur propre traitement.
Au XIXe siècle, des médecins comme James Braid en Angleterre rejettent l’idée de fluide magnétique mais conservent les techniques d’induction. Il forge le terme hypnose (du grec hypnos, sommeil), et développe une approche plus scientifique, fondée sur la suggestion mentale. Ainsi, le mesmérisme devient une étape clé dans la naissance de la psychologie expérimentale et de la psychothérapie.
Influence sur la littérature romantique
Le mesmérisme fascine les écrivains du XIXe siècle, notamment ceux du courant romantique, qui s’intéressent aux états extrêmes de la conscience, aux mystères de l’âme et aux forces invisibles. On retrouve des références au mesmérisme dans les œuvres de Balzac, Dumas, Poe, ou Baudelaire.
Par exemple, Edgar Allan Poe explore dans ses nouvelles les limites entre vie et mort, conscience et inconscience, souvent avec des personnages plongés dans des états hypnotiques ou mesmérisés. Balzac, dans Louis Lambert, évoque les pouvoirs mentaux et les états visionnaires inspirés du magnétisme.
Ces écrivains voient dans le mesmérisme une porte vers l’inconnu, une manière de sonder les profondeurs de l’esprit humain, bien avant que Freud ne formalise l’inconscient.